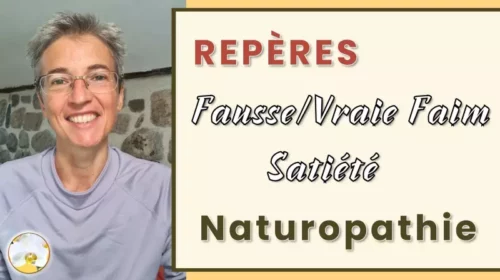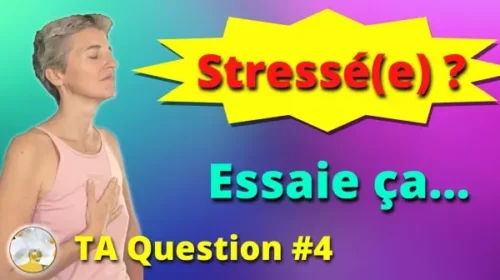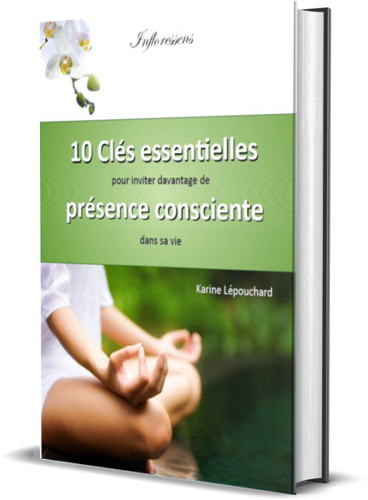Introspection et pardon, un chemin de guérison intérieure et d’amour de soi
Vidéo publiée le 22/08/2025
Ton soutien est précieux !
🚀 Si tu souhaites m’aider à améliorer la visibilité de cette vidéo sur YouTube, tu peux la liker 👍 et t’abonner à ma chaîne.
Note :
– Le contenu de l’article est plus complet que celui de la vidéo (voir sommaire ci-dessous).
– La vidéo étant chapitrée, tu peux aisément te rendre compte de son contenu et naviguer dedans afin de visionner les parties qui t’intéressent le plus.
Pardonner ?
Un mot simple, mais qui recouvre des réalités complexes. Derrière l’idée du pardon se cachent souvent des rôles bien ancrés : victime, bourreau, sauveur. Comprendre ces mécanismes, c’est déjà faire un pas vers un pardon plus authentique, plus libre, sans faux-semblants.
En tant que thérapeute holistique, j’ai pu observer lors de mes séances d’accompagnement en thérapie psychocorporelle, combien le pardon agit comme un puissant levier de transformation lorsqu’il est associé à une pratique d’introspection.
C’est chemin intérieur qui permet de se délester de la culpabilité, de transformer ses blessures en profondeur et de retrouver davantage de sérénité au quotidien.
📖 Sommaire de l’article :
- Contexte et définitions
- L’introspection, un processus de guérison intérieure
- Ce que le pardon n’est pas
- Qu’est-ce que pardonner vraiment ?
- Pardonner : un chemin à parcourir
- Le rôle de la victime
- Le rôle du sauveur
- Le rôle du bourreau
- Conclusion – Se libérer par le pardon
Contexte et définitions
L’introspection, un processus de guérison intérieure
Dans l’accompagnement thérapeutique d’une blessure passée, l’introspection passe par quatre aspects complémentaires à ressentir et à vivre pleinement, en lien avec l’événement difficile :
- Accueil : se permettre de ressentir pleinement, dans son corps, ce que cela nous fait d’avoir vécu cette expérience, en respirant, en intégrant les ressentis physiques, émotionnels, les pensées et croyances qui y sont liées.
- Acceptation : ne plus lutter contre la réalité de cette expérience et de ce que l’on ressent à son sujet. “C’est !”
- Pardon : celui dont nous allons parler ici.
- Gratitude : reconnaître profondément les cadeaux et les ressources que cette expérience nous a permis de développer et révéler. Nous sommes aussi qui nous sommes grâce à elle, même si elle a été douloureuse et que nous ne souhaiterions pas la revivre.
🧘♀️ Si tu veux tout savoir sur la pratique de l’introspection, je t’invite à découvrir l’article : Comment faire une introspection de soi – Guide complet
Ce que le pardon n’est pas
Pardonner n’est pas un acte de générosité ou de bienveillance envers quelqu’un qui nous aurait fait du mal. Ce n’est pas dire : “Va en paix, je te pardonne du haut de ma grandeur d’âme.”
Non.
Le pardon est avant tout un processus d’amour et de libération de soi-même.
Pardonner, ce n’est pas non plus valider ou excuser ce que l’autre a fait. Non, il n’a pas “bien fait” – inutile d’exagérer ! On a souffert. On ne le nie pas. On ne l’oublie pas non plus.
Ce n’est pas davantage revenir vers l’autre « comme si de rien n’était ». Certaines personnes peuvent rester toxiques pour nous. Parfois, c’est la dynamique entre elles et nous qui l’est. Cela peut évoluer… ou pas. En tout cas, pardonner ne signifie pas avoir à renouer le contact.
Qu’est-ce que pardonner vraiment ?
Pardonner, c’est renoncer à la culpabilité – celle de l’autre comme la nôtre. Renoncer aux griefs, annuler le contentieux.
C’est voir les expériences vécues comme une intrication de causes et d’effets, en reconnaître la perfection et les aimer pour ce qu’elles sont : une somme d’expériences.
Facile à écrire… mais si difficile à ressentir pleinement.
Le corps, lui, ne ment pas. J’utilise énormément la conscience des ressentis et la respiration lors des séances de thérapie psychocorporelle.
Nos sensations physiques vis-à-vis d’une personne ou d’une situation nous indiquent où nous en sommes dans un processus de pardon.
- Si ça serre, se tend, se ferme, si la respiration se bloque ou devient difficile… on n’y est pas encore.
- Si c’est ouvert, posé, tranquille et que la respiration est fluide… alors oui, on y est. Ouf !

Pardonner : un chemin à parcourir
Pardonner est un processus. Cela s’apprend !
Comment apprend-on à pardonner ?
La culpabilité revêt principalement 3 visages : la victime, le sauveur, le bourreau/persécuteur.
Ces trois rôles sont à identifier dans la situation concernée.
Le rôle de la victime
Est-ce que je m’identifie à la victime ?
Dans ce cas, j’accuse l’autre de m’avoir fait du mal.
Exemple 1 : « Il m’a insulté !«
Reconnaître la victime sans s’y identifier totalement
C’est une étape indispensable dans un parcours de guérison émotionnelle : reconnaître ce statut de victime. Cela correspond à la phase d’accueil et d’acceptation : « oui, j’ai vécu cela, oui, j’ai ressenti cela…« . C’est.
Non, ce n’était pas normal de vivre ça.
Mon intégrité a été malmenée.
J’ai de très bonnes raisons d’être mal.
La victime a besoin d’accueil, de reconnaissance, que l’on valide son vécu.
Le piège ? En rester là !
Valider et graver dans le marbre : « je suis la victime (donc la gentille) de l’autre qui est un méchant. »
C’est tentant, car il y a de réels bénéfices paradoxaux à rester dans cette position :
- Je suis la gentille, j’ai le beau rôle.
- J’ai l’attention des autres.
- Je peux parfois demander à être indemnisé du préjudice subi.
- Je suis impuissante, donc je ne peux pas faire de mal à qui que ce soit. Je ne prends aucun risque : je ne vais donc pas me tromper, ni faire d’erreur à mon tour (peur de l’échec, peur de blesser).
- Le fait de me confronter régulièrement à des “méchants” me prouve que j’ai raison. Cela valide le travail de mes parts gardiennes qui cherchent à me protéger et qui développent des stratégies pour cela (analyse de l’autre, jugement, rejet, isolement…). Le système s’auto-entretient et ces parts croient bien faire : elles pensent préserver mon intégrité.
Impossible de guérir et de se libérer de cette expérience tant que je crois qu’il y a des gentils (dont je fais partie) et des méchants (dont je dois me protéger, qu’il faut punir, etc.).
Si je reste dans cette croyance, je vais la valider sans cesse, attirer à moi d’autres méchants et continuer à souffrir de leurs actions.
Je tourne en rond : c’est une prison mentale.
J’ai besoin de pardonner, c’est-à-dire de voir qu’il n’y a en réalité ni méchant ni gentil.
Lors de mes séances de thérapie psycho-corporelle, j’observe que ce moment constitue souvent un tournant délicat dans l’état d’esprit et la posture intérieure. C’est un véritable basculement, auquel tout le monde n’est pas forcément prêt d’emblée.
Pour que cette transformation puisse avoir lieu, il est essentiel d’y aller avec beaucoup de douceur et de finesse, en veillant à ce que la personne se sente en sécurité et sache que son intégrité est pleinement respectée.
Avancer vers le pardon malgré les bénéfices paradoxaux
On commence par accueillir pleinement la victime en soi (sans la figer dans ce rôle). On accepte ce qui a été vécu. On envisage aussi les cadeaux cachés de la situation (gratitude).
Quand on se sent prêt, on cherche à redonner un visage plus humain au bourreau, à le comprendre, à se relier de manière plus empathique à lui.
Rappel important : on ne fait pas cela pour lui, mais pour soi. Pour comprendre. Pour éclairer la situation sous un nouveau jour qui permette de guérir et de se libérer.
Exemple 1 : Il m’a insulté !
- Pourquoi a-t-il fait cela ?
- Que ressentait-il ?
- Comment en est-il arrivé là ?
Parfois, quand l’émotionnel est déjà partiellement apaisé, on peut aller parler directement à la personne et lui poser ces questions.
Attention ! Il est nécessaire d’être dans une ouverture réelle et une posture empathique. Impossible si l’on n’a pas déjà bien accueilli et apaisé la victime en soi. La présence d’un médiateur impartial peut être précieuse.
Parfois, ce n’est pas possible ou on ne s’en sent pas capable.
On peut alors, avec l’aide d’un thérapeute, formuler des hypothèses, reconstituer la scène intérieurement. On rassemble ce que l’on sait de la personne, de son histoire, de ses conditionnements, de son caractère, de sa personnalité, de son niveau de conscience…
C’est un travail d’enquête dont on ne tirera pas de réponses définitives — ce n’est pas le but.
L’essentiel est que le bourreau reprenne à nos yeux une dimension humaine, à laquelle on puisse se relier… Le défit, c’est que l’on puisse progressivement se reconnaître en lui !
Ni victime ni bourreau
Reprenons notre exemple : « Il m’a insulté !«
Oui, il a commis une erreur, il n’aurait pas dû.
Mais est-ce que moi aussi je fais parfois des erreurs ?
Ai-je déjà agi de façon similaire ou dans un autre contexte ?
Avait-il vécu quelque chose juste avant qui puisse expliquer son comportement ?
Dans quel état d’esprit était-il ? Que ressentait-il ? Qu’imaginait-il ?
A-t-il projeté quelque chose de sa propre histoire sur cette situation ?
Puis-je mesurer les défis qui sont les siens ?
Sais-je vraiment comment j’aurais réagi à sa place ?
Se pourrait-il qu’il ait eu un besoin ou une limite qu’il n’a pas su exprimer autrement ?
Et moi, est-ce que parfois j’exprime mes besoins ou mes limites de manière maladroite, voire blessante ?
Encore une fois, je me pose ces questions pour me relier avec plus de conscience à ce “bourreau” et accéder à l’être humain derrière l’étiquette. Je le fais pour moi, pour guérir et me libérer.
Dans ce processus, on navigue souvent entre la quête de pardon, l’accueil, l’acceptation et la gratitude. Ce n’est pas un cheminement linéaire.
Puis, un jour, on sent que c’est bon. Il n’y a plus d’accusation. On voit, on comprend. On peut tourner la page et avancer.
Comme un fruit mûr qui tombe de l’arbre, ça lâche à l’intérieur.
C’est fini.
🎁 Tu trouveras de nombreuses Ressources Gratuites avec des méditations, des pratiques de présence à soi et de respiration (vidéos, mp3 à télécharger…) sur ma Plateforme en ligne.
Toutes les informations sont sur cette page :
Le rôle du sauveur
Est-ce que tu t’identifies au sauveur ?
Ici, tu accuses l’autre d’avoir fait du mal à un tiers que tu cherches à défendre.
Exemple 2 : « Ce salaud a trompé ma meilleure amie !«

Pourquoi le sauveur reste dans son rôle
Là encore, il peut y avoir des bénéfices paradoxaux à rester identifié au rôle de sauveur :
- Le sauveur se sent puissant (en apparence) et animé de bonnes intentions : il défend la veuve et l’orphelin.
Exemple 2 : je défends mon amie face à ce “salaud”. - Mais le sauveur a besoin de victimes à défendre ! Or, maintenir quelqu’un dans une posture de victime ne l’aide pas réellement. Cela l’empêche d’avancer vers la guérison.
Exemple : Peut-être que mon amie aurait besoin de changer de regard sur sa relation ? Elle pourrait reprendre sa responsabilité, voir comment elle a co-créé cette situation. Elle pourrait aussi mesurer ce qui se rejoue intérieurement pour elle, identifier des résonances avec son passé. - Le sauveur peut aussi chercher inconsciemment à se racheter d’une culpabilité passée. Il s’identifie alors au bourreau. Tant qu’il ne s’est pas pardonné ses propres “méfaits”, il aura tendance à protéger des victimes contre des bourreaux qui lui rappellent ce qu’il se reproche lui-même.
Exemple 2 : Ce sauveur a trompé son ex, ce qui a provoqué la fin de la relation. Ne se le pardonnant pas, il prend aujourd’hui systématiquement parti dès qu’il voit quelqu’un tromper son partenaire. - L’histoire personnelle du sauveur peut également l’amener à s’identifier à la victime. Ayant vécu des expériences similaires, il tente de réparer symboliquement sa propre histoire en s’occupant d’elle.
Exemple 2 : L’ex du sauveur l’a trompé à plusieurs reprises, ce qui lui a fait vivre beaucoup d’humiliation. Aujourd’hui, lorsqu’il voit quelqu’un tromper son partenaire, une douleur intense refait surface.
Plus largement : si je remarque que je prends facilement parti et que je défends spontanément ceux que je perçois comme des victimes, il serait utile de me demander :
- Pourquoi suis-je sans cesse tenté(e) de défendre ces personnes ?
- Pourquoi utiliser mon temps et mon énergie de cette manière ?
- Est-ce que je fuis quelque chose dans ma propre vie, dont je n’arrive pas à m’occuper pour moi-même ?
Revenir à soi
Le sauveur a besoin de revenir à lui-même pour identifier ce qui, dans sa propre vie ou son histoire, réclame son attention.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus aider les autres ! Mais l’aide sera plus juste et plus efficace si elle ne part pas d’un espace de culpabilité ou de jugement.
Aider sans prendre parti ni maintenir l’autre dans un rôle de victime qu’il s’attribue, c’est possible. Et c’est même souvent beaucoup plus libérateur pour lui… et pour soi.
Le rôle du bourreau
Suis-je le bourreau ?
Parfois, oui.
Exemple 3 : « J’ai giflé mon enfant !«
Quand le bourreau est en nous
On peut être confronté à notre propre “bourreau intérieur” :
- Directement : j’ai fait quelque chose que je me reproche.
- Indirectement :
- en tant que sauveur, je me rends compte que j’ai moi-même quelque chose à me pardonner,
- en tant que victime, je découvre que j’ai eu ma part de responsabilité… voire que j’ai déjà fait bien pire que mon “bourreau” !
Des rôles qui tournent
Dans le monde de la culpabilité, les étiquettes changent sans cesse : parfois victime, parfois sauveur, parfois persécuteur.
Très souvent, sur le chemin, on finit par devoir se pardonner à soi-même.
Nos conditionnements, programmations et héritages
Plusieurs facteurs nourrissent la culpabilité :
Les programmations sociales culpabilisantes
Elles sont souvent intégrées dès l’enfance et deviennent presque invisibles à nos yeux tant elles nous semblent “normales”. Les reconnaître est la première étape pour choisir, en conscience, d’en sortir.
Exemple : Les interdits et limites posés dans l’éducation. On peut éduquer par la culpabilité et la punition humiliante — ce qu’Alice Miller appelle la violence éducative ordinaire — ou au contraire, par l’exemplarité et le dialogue cœur à cœur.
Dans le premier cas, l’enfant apprend à agir par peur de décevoir ou d’être puni. Dans le second, il apprend à développer sa propre boussole intérieure et à comprendre l’impact de ses actes.
Un héritage familial et scolaire
Notre famille et notre parcours scolaire nous transmettent des croyances, des règles implicites, des schémas de pensée et parfois même des “étiquettes” qui façonnent notre vision de nous-même.
Un simple commentaire répété (“Tu es égoïste”, “Tu ne te rends pas compte de ta chance”, “Pense à ceux qui meurent de faim”, “Fais plaisir à ...”) peut créer un sentiment de culpabilité tenace, même à l’âge adulte.
Ces empreintes peuvent conditionner nos choix et nos réactions bien plus qu’on ne l’imagine.
Culpabilité transgénérationnelle

Ce qui était perçu comme honteux ou inacceptable par nos aïeux ne l’est plus forcément aujourd’hui. Des “mises à jour” sont parfois nécessaires pour vivre selon nos propres valeurs.
Les culpabilités familiales, la loyauté à des secrets et non-dits pèsent parfois sur plusieurs générations. Les mettre en lumière et les guérir en soi permet aussi de libérer la lignée dont nous sommes issus.
Exemple : une femme peut porter inconsciemment la honte de sa grand-mère d’avoir eu un enfant hors mariage, alors qu’aujourd’hui, cela n’a plus la même signification sociale.
Culpabilité provenant du collectif
Les sociétés, cultures et religions façonnent elles aussi notre rapport à la culpabilité.
- Dans la religion catholique, par exemple, l’humain est considéré coupable dès la Genèse, “pécheur” par nature.
- L’ingénierie sociale à travers la communication institutionnelle et les médias peut aussi exploiter la culpabilité comme levier de contrôle, en la combinant avec la peur.
Exemple : Pendant le Covid, le message “Si tu vas voir mamie, tu vas la tuer !” a été utilisé pour influencer les comportements.
Les effets de la culpabilité massive
Lorsqu’elle est entretenue à grande échelle, la culpabilité engendre frustration et perversion. Les besoins humains fondamentaux — besoins de lien, de reconnaissance, de liberté, de plaisir — finissent par chercher des voies détournées pour s’exprimer. Dans ce contexte, la transgression peut devenir une forme d’ivresse, un moyen de se réapproprier un sentiment de liberté.
Quels sont les enjeux du pardon à soi-même ?
Se pardonner à soi-même, c’est sortir de ces héritages et conditionnements.
Les enjeux ?
- Devenir adulte et autonome dans ses choix et ses positionnements.
- Devenir capable de créer sa vie en conscience, au-delà des problématiques de survie, d’appartenance et de reconnaissance.
Pour cela, il est nécessaire d’aller rencontrer, aimer, guérir et réintégrer les nombreux aspects de soi qui ont été jugés, rejetés ou laissés de côté.
C’est un processus patient, mais profondément libérateur.
Se relier à soi, malgré la honte et la culpabilité

Il s’agit de se poser le même genre de questions que celles que nous avons vues plus haut lorsqu’il s’agissait de libérer la victime. Cette fois, c’est de soi dont il s’agit.
Exemple 3 : « J’ai giflé mon enfant !«
- Pourquoi ai-je fait cela ?
- Qu’ai-je ressenti ?
- Comment en suis-je arrivé là ?
On rassemble des éléments sur soi : son histoire, ses conditionnements, sa personnalité, son état de conscience au moment des faits.
C’est un travail d’enquête qui nous relie à nous-même. On cherche à se comprendre, à donner du contexte.
On observe ce qui nous a menés là et ce que cela a produit :
- Quelles conséquences dans ma vie ?
- Quelles conséquences pour les autres personnes impliquées ?
- Qu’ai-je appris de cette expérience ? Quelle sagesse puis-je en tirer pour l’avenir ?
Pendant ce processus, on continue à s’accueillir, à se laisser traverser par les émotions, à observer pensées et croyances. On ne se lâche pas la main.
L’amour est au cœur de ce chemin. Il nous permet d’avancer. Il grandit à mesure que l’on s’autorise à se pardonner :
“Là où j’en étais à ce moment-là, je n’avais pas les ressources ni les moyens de faire autrement. C’est sorti sans que je puisse le contrôler.”
Puis, peu à peu :
- Oui, j’ai fait une erreur. Je n’aurais pas dû, c’est sûr. Mais c’est fait.
- Voilà ce que j’ai ressenti, voilà ce que j’ai cru.
- Voilà ce que j’ai appris.
💗 Tu trouveras dans le Module 1 Plus de stabilité et de douceur chaque jour un espace entièrement dédié à l’apprentissage de l’amour de soi, avec des explications en vidéo, des pratiques guidées et des mises en action simples.
À partir de cet espace plus doux, peut-être souhaiteras-tu exprimer quelque chose à la personne impliquée.
Présenter des excuses sincères ?
Demander s’il est possible de réparer ?
Rétablir une connexion plus authentique ?

Chaque situation est différente : parfois on le souhaite, parfois ce n’est pas une bonne idée.
Là encore, on navigue entre pardon, accueil, acceptation et gratitude.
Et puis, un jour, on sent que c’est fait. Il n’y a plus d’accusation. On voit, on comprend. On n’a plus besoin de s’y attarder.
Là encore, comme un fruit bien mûr tombe de l’arbre… ça lâche.
C’est fini.
On peut tourner la page et avancer.
Conclusion – Se libérer par le pardon
Avec cet article j’imagine que tu comprends mieux pourquoi l’acte de pardonner n’est pas un geste envers l’autre. C’est un chemin vers soi.
C’est accueillir, questionner pour comprendre, se relier, aimer, intégrer… et enfin tourner la page pour avancer plus léger(e).
Ce chemin peut être complexe, subtil, parfois déroutant… mais il est profondément libérateur.
Si tu souhaites être accompagné(e) pour explorer certaines blessures de ton passé, comprendre tes mécanismes émotionnels et vivre un véritable parcours de libération psychocorporelle, je t’invite à découvrir mes accompagnements.
Ensemble, nous pouvons créer l’espace dont tu as besoin pour guérir, retrouver davantage de joie et de sérénité.